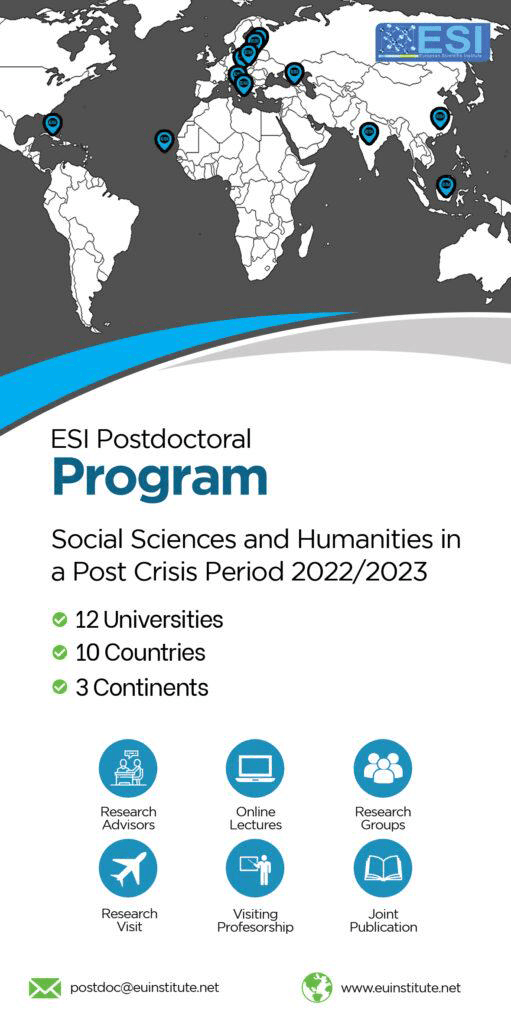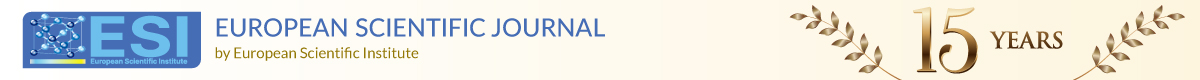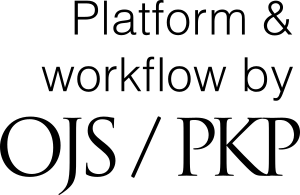Lorsque le symbolique transcende les frontières terrestres entre le Cameroun et ses voisins : la contribution des mariages transfrontaliers à l’intégration sous-régionale en Afrique centrale
Abstract
Située au carrefour de la socio-anthropologie et de la sociologie des relations internationales, la présente réflexion examine l’apport des mariages transfrontaliers dans la construction de l’intégration sous-régionale en Afrique centrale. Prenant corps au sein des espaces frontaliers nord et sud Cameroun, elle repose sur la conjecture principale que ces unions transfrontalières comme symboles, participent à bien des égards à transcender les frontières terrestres entre le Cameroun et ses voisins. Pour le démontrer, un dispositif méthodologique articulé autour des entretiens et des observations a été opérationnalisé au sein de certaines localités frontalières du département de la vallée du Ntem dans le Sud Cameroun et ceux du département du mayo-Rey dans la région nord. Les données premières recueillies ont été complétées par celles dites secondaires. L’exploitation de ces dernières a principalement été éclairée à la lumière du néo-régionalisme comme approche théorique. De celles-ci, il en ressort qu’au-delà des spécificités liées aux pratiques matrimoniales chez les peuples frontaliers Mboum et Ekang qui structurent ces espaces, les mariages transfrontaliers ayant lieu à partir de ces espaces ont des incidences plurielles sur la dynamique d’intégration sous-régionale en Afrique centrale. Ils se révèlent à cet effet comme des instruments de renforcement, d’approfondissement des liens de solidarité et de fraternité entre les populations frontalières locales et celles des pays voisins. La prise en compte des réalités sociologiques et socio-anthropologiques qui traversent les pays qui composent la sous-région rendrait plus opérantes les actions des politiques. Car, au-delà d’intégrer les Etats, l’intégration régionale vise également à intégrer les hommes.
Situated at the crossroads of socio-anthropology and the sociology of international relations, this reflection examines the contribution of cross-border marriages to the construction of sub-regional integration in Central Africa. Taking form within the border areas of northern and southern Cameroon, it is based on the main conjecture that these cross-border unions, as symbols, contribute in many ways to transcending the land borders between Cameroon and its neighbors. To demonstrate this, a methodological framework structured around interviews and observations has been implemented in certain border localities of the Ntem Valley department in southern Cameroon and those of the Mayo-Rey department in the northern region. The primary data collected has been supplemented by so-called secondary data. The exploitation of the latter has primarily been illuminated in the light of neo-regionalism as a theoretical approach. From this, it emerges that beyond the specificities related to marriage practices among the Mboum and Ekang border communities that structure these spaces, cross-border marriages taking place from these areas have multiple impacts on the dynamics of sub-regional integration in Central Africa. They thus prove to be instruments for strengthening and deepening bonds of solidarity and fraternity between local border populations and those of neighboring countries. Considering the sociological and socio-anthropological realities that cross the countries making up the sub-region would make the actions of policymakers more effective. For, beyond integrating states, regional integration also aims to integrate people.
Downloads
References
2. Badie, B., & Devin, G., (2007). Le multilatéralisme : nouvelles formes de l’action internationale, la Découverte, Paris
3. Ernst, H., cité par Lequesne, C., (1996). « la commission européenne entre autonomie et dépendance », revue française de science politique, vol.46, n°3, p.292
4. Mvelle, G., (2014). Intégration et coopération en Afrique, l’harmattan, Paris, p.10
5. Weinberg & Gerhard, L., (2005). A World at Arms – A Global History of World War II, Cambridge University Press, P.1178
6. Judt, T., (2005). Postwar : A History of Europe since 1945, Penguin Books, New York
7. Kontchou-kouomegni, A., (1977). Le Système diplomatique africain bilan et tendance de la première décennie, Paris pédonne, 1977, p.55
8. Saurugger (S). (2013). Théorie et concepts de l’intégration européenne, Paris, Science po presses.
9. Balassa, B., (1964). Théorie of economic intégration, in revue économique, volume 15, n°1, 1964. P.145-146
10. Hammouda, H., (2003). L’intégration régionale en Afrique centrale : bilan et perspectives, Paris, Karthala, 2003, p.303
11. Choualat, Y., (2004). « La crise diplomatique de Mars 2004 entre le Cameroun et la Guinée Equatoriale : fondements, enjeux et perspectives » in polis, revue camerounaise de science politique, vol.12, numéro spécial 2004-2005
12. Awoumou, C., (2008). Le couple Cameroun-Gabon au sein de la CEMAC, Paris, l’harmattan, p.435
13. Loungou, S., (2010). « La libre circulation des personnes au sein de l’espace CEMAC : entre mythe et réalités » in belgeo, mars 2010, mis en ligne le 04 décembre 2012, consulté le 10 décembre 2020, p.119
14. Batchom, E., (2012). « La rupture du consensus de fort-Lamy et le changement du rapport de force dans l’espace CEMAC », in revue études internationales, vol XLIII, n° 2, juin 2012, PP.147-167
15. Ntamack Ntamack, (J)., (2016). Les régionalismes africains : essai d’analyse des logiques d’intégration régionale à travers les expériences de la CEMAC, de la CEEAC et de la CEDEAO, Thèse de Doctorat PhD en science politique, université de Douala
16. Hugon, P., (2017). « Régionalisme et régionalisation : limites de jure et réussites contrastées » in revue intervention économique, mars
17. Bilongo, D., (2023). La dialectique Etat/intégration régionale en Afrique centrale Cemac : une analyse à partir du Cameroun. Thèse de Doctorat PhD en science politique, Université de Yaoundé II
18. Bennafla, K., (2002). Le commerce frontalier en Afrique Centrale, Paris, Karthala, p.353
19. Herrera, J., (1998). « Du fédéral et des Koweitiens : la fraude de l’essence nigériane au Cameroun » in Johny Egg, Javier Herrera, échanges transfrontaliers et intégration régionale en Afrique subsaharienne, Saint-Etienne, éditions de l’aube, P.181
20. Abwa, D., (2011). Dynamiques d’intégration régionale en Afrique centrale, Presse universitaire Yaoundé, Tom1, Novembre, p.465
21. Essomba, J-M., (2011). « Le passé composé de l’intégration régionale en Afrique Centrale » in Abwa D., dynamiques d’intégration régionale en Afrique centrale, Presse universitaire Yaoundé, Tom1, Novembre, p.465
22. Owona Nguini, M-E, & Deli Sainzoumi. D., (2005). « À qui profite les flux transfrontaliers entre Ndjamena et Kousseri : échanges, territoires et dialectique du licite et l’illicite » in revue enjeux n° 29, novembre, pp.16-19
23. Ango Mengue, S., (2011). « Relations frontalières entre les peuples du Cameroun et les autres pays de l’Afrique centrale : le cas de l’Est » in Abwa D., dynamiques d’intégration régionale en Afrique centrale, Presse universitaire Yaoundé, Tom1, Novembre 2011, p.465
24. Noubissi, Y., (2024). « Les festivals culturels traditionnels Ekang et Mboum : entre valorisation culturel et instrument d’intégration régionale en Afrique centrale » in revue internationale de Droit et de science politique, Vol. 4, septembre
25. Ferrol, G., (2009). Dictionnaire de sociologie, Paris, Armand colin, p.12
26. Maité, M., (2013). « L’amour et ses frontières : régulations étatiques et migrations de mariage (Belgique, France, suisse et Italie) » in migrations sociétés, 06, n° 150, P.41-60
27. Nicola, E., (2005). « Cross-border marriages : gender and mobility in transnational Asia, Philadelphia : university of Pennsylvania Press, 2005, 220.P ; phillipe & claudine, « mixités amoureuse, des conjugalités aux multiples facettes », projet, n°292, Mai, PP.12-19
28. Malam, S., (2019). « Les chefs traditionnels du Nord-Cameroun et la gouvernance locale » in Idrissou Alioum et Alawadi Zelao (dr), le Cameroun septentrional contemporain. Figures, sociétés et enjeux de développement, 2ème ed, Yaoundé, les éditions Danimber et Larimber, 2019. PP. 323-352
29. Ndougsa V., (2018). Les peuples Beti du Cameroun : origines, ethnies et traditions, paris, l’harmattan, P.38
30. Pierre, A., & Binet, J., (1958). Le groupe dit Phaouin, Paris, presses universitaires de France, P.51
31. Radcliffe-Brown, A-R., & Forde, D., (1951). Systèmes familiaux et matrimoniaux en Afrique, Paris, Presse universitaire de France, P.61
32. Assoumou, A., (1998). Le mariage à la dot chez les fang du Gabon, thèse Doctorat en sociologie, université Laval Québec, 1998, P. 217
33. Ndougsa, V., (2018). Op.cit.,
34. Aubame, J-M., (2002). Les Beti du Gabon et d’ailleurs : croyances, us et coutumes, Tom2, Paris, l’harmattan, P.194
35. Froelich, J., (1959). Notes sur les Mboum du Nord-Cameroun. In : journal de la société des Africanistes, tome 29, fascicule1. P.91-117
36. Boumane, O., (2022). Les mbum à la croisée des chemins : l’essence Mbum, tom1, dinimber larimber, Yaoundé, p.74
37. Abe, C., (2019). « Conflit, violence et gestion/ régulation de la transition politique en milieu rural au Cameroun : les autorités traditionnelles à l’épreuve des élites politiques dans le lamidat de Rey Bouba » in Idrissou Alioum et Alawadi Zelao (dr), le Cameroun septentrional contemporain. Figures, sociétés et enjeux de développement, 2ème ed, Yaoundé, les éditions Danimber et Larimber, 2019. PP.515-545
38. Laoula, E., (2022). Mon combat pour la culture Mboum, Paris, Les impliqués, 2022, P.29
39. Antoine, P., (2002). « L’approche biographique de la nuptialité : application à l’Afrique », dans G. Caselli, J. Vallin et G. Wunsch (dir.), Démographie : analyse et synthèses, vol. 2 : Les déterminants de la fécondité, Paris, INED, p. 51-74.
40. Entretien avec un employé d’hôtel (Saratel) de kyé-ossi, le 14 novembre 2023, de 13H15 à 14H05
41. Mahouachi, L., (2008). « La citoyenneté européenne : un catalyseur du pluralisme des identités en Europe ou comment relancer la participation citoyenne au projet politique européen », mémoire de master, institut européen de l’université de Genève, Mars, P.17
42. Moussa & Sinang, J., (2015). « Migrations et peuplement du Sud-Est Cameroun : une contribution à la problématique de l’intégration sous-régionale en Afrique centrale » in Norodom kiari, J-B., De l’intégration régionale en Afrique centrale (1960-2010), Paris, l’harmattan, PP.146-179
43. Ndjidda, A., (2019). « Diplomatie locale tchado-Camerounaise : une coopération bilatérale par le bas » in Idrissou, A., et Alawadi Z., le Cameroun septentrional contemporain : figures, sociétés et enjeux de développement, 2ème ed, Yaoundé, les éditions Dinimber et Larimber, PP.179-212
44. Domo, J., (2013). Les relations entre frontaliers Cameroun-Tchad, Paris, l’Harmattan, 2013, P.78-81
45. Saibou, I., (2012). Ethnicité, frontières et stabilité aux confins du Cameroun, du Nigéria et du Tchad. Paris, L’Harmattan, P.151
46. Noubissi, Y., (2025). « Liens ethniques transfrontaliers et activités illicites : une étude de leur interrelation aux frontières nord et Sud Cameroun » in European scientific Journal, ESJ, 21 (8), P.149
47. Akono, F., (2024). Immigration clandestine en zone transfrontalière Cameroun-Gabon-Guinée Equatoriale. Une analyse à partir des facteurs socio-anthropologiques et économiques du phénomène en zone CEMAC, éditions Universitaires Européennes, P.168
48. Bach, D., (2009). « Régionalisme, régionalisation et globalisation » in : Mamoudou Gazibo et Céline Thiriot (dir), l’Afrique en science politique, Paris : Karthala,
49. Noubissi, Y., (2019). Les dynamiques socioculturelles dans la construction de l’intégration régionale en Afrique centrale : le cas de l’espace CEMAC, mémoire de master en science politique, université de Yaoundé II,
50. Mongbet, A., (2022). Mobilités, dynamiques frontalières et intégration sous-régionale en zone CEMAC : le cas des commerçants de Kyé-ossi, Thèse de Doctorat PhD en géographie, Université de Poitiers,
51. Tsala, M., (2016). Les peuples frontières et la dynamique d’intégration régionale en Afrique centrale : cas des fang de la zone frontalière Cameroun-Gabon-Guinée équatoriale. Mémoire master en science politique, université de Yaoundé 2,
52. Medjo medjo, M., (2021). L’influence de l’ethnicité sur le commerce frontalier : le cas de la ville de Kyé-ossi au sud Cameroun, Thèse de Doctorat en sociologie, université Stellenbosch,
53. Battistella, D., (2006). Théories des relations internationales, sciences Pô, 2ème édition revue et augmentée, Paris, P. 359
54. Sindjoun, L., (2002). Sociologies des relations internationales Africaines, Paris, Karthala, P.
Copyright (c) 2025 Yvan Nathanael Noubissi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.